Non seulement les États-Unis ont contribué à créer les conditions permettant aux Khmers rouges d’accéder au pouvoir au Cambodge en 1975, mais ils ont également soutenu activement cette force génocidaire, tant sur le plan politique que financier. Dès janvier 1980, les États-Unis finançaient secrètement les forces exilées de Pol Pot à la frontière thaïlandaise. L’ampleur de ce soutien – 85 millions de dollars entre 1980 et 1986 – a été révélée six ans plus tard dans une correspondance entre Jonathan Winer, avocat du Congrès et alors conseiller du sénateur John Kerry (Démocrate-Massachusetts) de la commission des affaires étrangères du Sénat, et la Vietnam Veterans of America Foundation. Winer a déclaré que ces informations provenaient du Congressional Research Service (CRS). Lorsque des copies de sa lettre ont été diffusées, l’administration Reagan était furieuse. Puis, sans expliquer clairement pourquoi, Winer a réfuté ces chiffres, sans toutefois contester qu’ils provenaient du CRS. Dans une deuxième lettre adressée à Noam Chomsky, Winer a toutefois réitéré l’accusation initiale, qu’il m’a confirmée, la déclarant « absolument correcte ».
Source : The World Traveler, John Pilger
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
Washington a également soutenu les Khmers rouges par l’intermédiaire des Nations unies, lesquelles ont fourni à Pol Pot le moyen de revenir au pouvoir. Bien que le gouvernement khmer rouge ait cessé d’exister en janvier 1979, chassé par l’armée vietnamienne, ses représentants ont continué à occuper le siège du Cambodge à l’ONU. Ce droit a été défendu et encouragé par Washington qui y voyait un prolongement de la Guerre froide, un moyen pour les États-Unis de se venger du Vietnam et un élément de sa nouvelle alliance avec la Chine (principal bailleur de fonds de Pol Pot et ennemi de longue date du Vietnam). En 1981, le conseiller à la Sécurité nationale du président Carter, Zbigniew Brzezinski, a déclaré : « J’ai encouragé les Chinois à soutenir Pol Pot. » Il a ajouté que les États-Unis avaient « fermé les yeux » lorsque la Chine avait envoyé des armes aux Khmers rouges via la Thaïlande.
Pour couvrir sa guerre secrète contre le Cambodge, Washington a créé le Kampuchean Emergency Group (KEG) à l’ambassade américaine de Bangkok et à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le KEG avait pour mission de « surveiller » la distribution de l’aide humanitaire occidentale envoyée aux camps de réfugiés en territoire thaïlandais et de s’assurer que les bases des Khmers rouges étaient approvisionnées. En collaboration avec la « Task Force 80 » de l’armée thaïlandaise, qui avait des officiers de liaison avec les Khmers rouges, les Américains ont assuré un flux constant de fournitures de l’ONU. Deux travailleurs humanitaires américains, Linda Mason et Roger Brown, ont écrit plus tard : « Le gouvernement américain a insisté pour que les Khmers rouges soient approvisionnés… Les États-Unis souhaitaient que l’opération menée par les Khmers rouges soit crédible grâce à une opération humanitaire de renommée internationale ».
En 1980, sous la pression des États-Unis, le Programme alimentaire mondial (PAM) a remis à l’armée thaïlandaise des vivres d’une valeur de 12 millions de dollars afin qu’elle les transmette aux Khmers rouges. Selon l’ancien secrétaire d’État adjoint Richard Holbrooke, « 20 000 à 40 000 rebelles de Pol Pot en ont bénéficié. » Cette aide leur a permis de redevenir une force combattante, implantée en Thaïlande, à partir de laquelle ils ont déstabilisé le Cambodge pendant plus d’une décennie.
Bien qu’il s’agisse de toute évidence d’une opération du département d’État, les principaux responsables du KEG étaient des officiers de renseignement ayant une longue expérience de l’Indochine. Au début des années 1980, il était dirigé par Michael Eiland, dont la carrière témoigne de la continuité de l’intervention américaine en Indochine. Dans les années 1969-1970, il était responsable des opérations d’un groupe clandestin des forces spéciales du nom de « Daniel Boone », qui était chargé de la reconnaissance en vue des bombardements américains au Cambodge. En 1980, avec le grade de colonel, il dirigeait le KEG depuis l’ambassade américaine à Bangkok, laquelle était décrite comme une organisation « humanitaire ». Chargé d’interpréter les photos de surveillance satellite au Cambodge, il était devenu une source précieuse pour certains journalistes occidentaux résidant à Bangkok, qui le qualifiaient dans leurs reportages « d’analyste occidental. » Ses fonctions « humanitaires » lui ont valu d’être nommé chef de la Defense Intelligence Agency (DIA) en charge de la région Asie du Sud-Est, l’un des postes les plus importants dans le domaine de l’espionnage américain.
En novembre 1980, l’administration Reagan, qui venait d’être élue, et les Khmers rouges ont établi un contact direct lorsque le Dr Ray Cline, ancien directeur adjoint de la CIA, s’est rendu secrètement dans un quartier général opérationnel des Khmers rouges au Cambodge. Cline était alors conseiller en politique étrangère au sein de l’équipe de transition du président élu Reagan. En moins d’un an, selon des sources à Washington, 50 agents de la CIA dirigeaient les opérations de Washington au Cambodge depuis la Thaïlande. La frontière entre l’opération internationale de secours et la guerre menée par les États-Unis est devenue de plus en plus floue. Par exemple, un colonel de l’Agence de renseignement de la défense (DIA) a été nommé « officier de liaison pour la sécurité » entre l’Opération de secours frontalière des Nations unies (UNBRO) et l’Unité de protection des personnes déplacées (DPPU). À Washington, des sources ont révélé qu’il servait de lien entre le gouvernement américain et les Khmers rouges.
L’ONU en tant que base
A compter de 1981, plusieurs gouvernements, y compris ceux des alliés des États-Unis, ont commencé à manifester leur réserve face à la mascarade consistant pour l’ONU à reconnaître Pol Pot comme chef légitime du pays. Ce malaise s’est manifesté de façon spectaculaire lorsqu’un de mes collègues, Nicholas Claxton, est entré dans un bar de l’ONU à New York en compagnie de Thaoun Prasith, le représentant de Pol Pot. « En quelques minutes, raconte Claxton, le bar s’était vidé. » Il était clair qu’il fallait faire quelque chose. En 1982, les États-Unis et la Chine, soutenus par Singapour, ont inventé la Coalition du gouvernement démocratique du Kampuchea qui, comme l’a souligné Ben Kiernan, n’était ni une coalition, ni démocratique, ni un gouvernement, ni au Kampuchea. Il s’agissait plutôt de ce que la CIA appelle « une illusion magistrale ». À sa tête fût nommé l’ancien dirigeant du Cambodge, le prince Norodom Sihanouk, mais à part ça, rien d’autre ne changea vraiment. Les Khmers rouges écrasaient les deux groupes « non communistes », les Sihanoukiens et le Front national de libération du peuple khmer (KPNLF). Depuis son bureau à l’ONU, l’ambassadeur de Pol Pot, le très raffiné Thaoun Prasith, continuait de parler au nom du Cambodge. Proche collaborateur de Pol Pot, il avait appelé en 1975 les Khmers installés à l’étranger à rentrer chez eux, suite à quoi nombre d’entre eux « disparurent ».
Les Nations Unies étaient désormais l’instrument de la punition infligée au Cambodge. Dans toute son histoire, l’organisation mondiale n’a refusé son aide au développement qu’à un seul pays du tiers monde : le Cambodge. Non seulement l’ONU, sous la pression des États-Unis et de la Chine, a refusé au gouvernement de Phnom Penh un siège, mais les principales institutions financières internationales ont exclu le Cambodge de tous les accords internationaux sur le commerce et les communications. Même l’Organisation mondiale de la santé a refusé d’aider le pays. Au niveau national, les États-Unis ont refusé aux groupes religieux des licences d’exportation pour des livres et des jouets destinés aux orphelins. Une loi datant de la Première Guerre mondiale, le Trading with the Enemy Act [loi sur les relations commerciales avec l’ennemi, NdT], a été appliquée concernant le Cambodge et, bien sûr, le Vietnam. Pas même Cuba ou l’Union soviétique n’ont été soumis à une interdiction aussi complète, exempte de toute exception qu’elle soit humanitaire ou culturelle.
En 1987, le KEG avait été rebaptisé Kampuchea Working Group, dirigé par le même colonel Eiland de la Defense Intelligence Agency. La mission du groupe de travail consistait à fournir des plans de bataille, du matériel de guerre et des renseignements satellitaires aux membres dits « non communistes » des « forces de résistance ». Cette « feuille de vigne » non communiste a permis au Congrès, poussé par un fanatique anti-vietnamien – le représentant Stephen Solarz (Démocrate-New York) – d’approuver une aide « affichée » mais aussi une aide « secrète » estimée à 24 millions de dollars à destination de la « résistance ». Jusqu’en 1990, le Congrès a accepté la thèse saugrenue de Solarz voulant que l’aide américaine n’ait pas profité à Pol Pot ni même aidé celui-ci, et que les alliés des États-Unis responsables de massacres « ne sont même pas proches d’eux [les Khmers rouges] ».
Liens militaires
Alors que Washington payait les factures et que l’armée thaïlandaise assurait un soutien logistique, Singapour, en tant qu’intermédiaire, était le principal canal d’approvisionnement en armes occidentales. L’ancien Premier ministre Lee Kuan Yew était un fervent partisan des positions américaine et chinoise qui voulaient que les Khmers rouges fassent partie d’un accord de paix au Cambodge. « Ce sont les journalistes, disait-il, qui les ont dépeints comme des diables. »
Les armes provenant d’Allemagne de l’Ouest, des États-Unis et de Suède étaient directement acheminées par Singapour ou fabriquées sous licence par Chartered Industries, une entreprise appartenant au gouvernement de Singapour, avant d’être saisies par les Khmers rouges. La connexion singapourienne permettait à l’administration Bush de poursuivre son aide secrète à la « résistance », alors même que cette assistance enfreignait une loi votée par le Congrès en 1989 laquelle interdisait toute « aide létale », même indirecte, à Pol Pot. En août 1990, un ancien membre des forces spéciales américaines a révélé qu’il avait reçu l’ordre de détruire des documents prouvant la présence de munitions américaines en Thaïlande au profit des Khmers rouges. Ces documents, a-t-il déclaré, impliquaient le Conseil national de sécurité, l’organe consultatif du président en matière de politique étrangère.
En 1982, lorsque les gouvernements américain, chinois et de l’ASEAN [L’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a été crée par l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les Philippines en 1967, NdT] ont mis en place la « coalition » qui a permis à Pol Pot de préserver le siège du Cambodge à l’ONU, les États-Unis ont entrepris de former et d’équiper les factions « non communistes » de l’armée « de résistance ». Ces partisans du prince Sihanouk et de son ancien ministre, Son Sann, leader du KPNLF, étaient majoritairement des marginaux et des criminels. Mais cette résistance n’était rien sans la guérilla de Pol Pot, forte de 25 000 hommes bien entraînés, armés et motivés, dont le commandement était reconnu par le commandant militaire du prince Sihanouk, son fils Norodom Ranariddh. « Les Khmers rouges », disait-il, sont les « principales forces d’attaque » et leurs victoires étaient « célébrées comme les nôtres. »
La tactique de la guérilla, à l’instar de celle des Contras au Nicaragua, consistait à terroriser les campagnes en tendant des embuscades et en semant des mines dans les champs. De cette manière, le gouvernement de Phnom Penh serait déstabilisé et les Vietnamiens piégés dans une guerre intenable : leur « Vietnam » personnel. Pour les Américains de Bangkok et de Washington, le sort du Cambodge était lié à une guerre qu’ils avaient techniquement perdue sept ans plus tôt. « Saigner à blanc les Vietnamiens sur les champs de bataille du Cambodge » était une expression populaire chez les décideurs politiques américains. L’objectif ultime était de détruire l’économie vietnamienne déjà affaiblie et, si nécessaire, de renverser le gouvernement de Hanoï. Sur ces ruines, la puissance américaine pourrait à nouveau s’affirmer en Indochine.
Les Britanniques, qui disposaient de forces militaires spéciales en Asie du Sud-Est depuis la Seconde Guerre mondiale, ont également joué un rôle clé dans le soutien aux forces armées de Pol Pot. Après le scandale « Irangate » (échange d’armes contre des otages) qui avait éclaté à Washington en 1986, la formation des Cambodgiens est devenue une affaire exclusivement britannique. « Si le Congrès avait découvert que des Américains étaient impliqués dans une formation clandestine en Indochine, sans parler de Pol Pot », a déclaré une source du ministère de la Défense à Simon O’Dwyer-Russell du Sunday Telegraph de Londres, « la bulle aurait éclaté. C’était l’un de ces accords classiques entre Thatcher et Reagan. On a proposé à celle-ci que le SAS [Special Air Service, unité de forces spéciales britanniques, NdT] prenne en charge le programme cambodgien, et elle a accepté. »
L’impunité de Pol Pot à Washington
Peu après le début de la guerre du Golfe en janvier 1991, le président Bush a décrit Saddam Hussein comme « un nouvel Adolf Hitler. » L’appel de Bush pour un « nouveau Nuremberg » afin de juger Saddam en vertu de la Convention sur le génocide a trouvé un écho au Congrès et de l’autre côté de l’Atlantique, à Londres.
Cette diversion était particulièrement paradoxale. Depuis que le Führer originel est mort dans son bunker, les États-Unis ont entretenu un réseau de dictateurs aux tendances hitlériennes, de Suharto en Indonésie à Mobutu au Zaïre, en passant par divers mafieux latino-américains, dont beaucoup sont diplômés de l’École des Amériques de l’armée américaine. Mais un seul a été identifié par la communauté internationale comme un véritable « Adolf Hitler réactualisé », dont les crimes sont documentés dans un rapport de 1979 de la Commission des droits humains des Nations unies et sont qualifiés de « pires jamais commis dans le monde depuis le nazisme. » Il s’agit bien sûr de Pol Pot, qui ne pouvait que s’étonner de sa bonne fortune. Non seulement il a été cajolé, ses troupes ravitaillées, équipées et entraînées, ses émissaires ont bénéficié de tous les privilèges diplomatiques, mais en plus, à la différence de Saddam Hussein, ses protecteurs lui ont assuré qu’il ne serait jamais traduit en justice pour ses crimes.
Ces assurances ont été données publiquement en 1991, lorsque la sous-commission des droits humains des Nations Unies a retiré de son ordre du jour un projet de résolution sur le Cambodge qui faisait référence aux « atrocités atteignant le niveau du génocide commises en particulier pendant la période du régime des Khmers rouges ». De plus, la commission des Nations unies a décidé que les gouvernements membres ne devaient plus chercher à « détecter, arrêter, extrader ou traduire en justice les responsables de crimes contre l’humanité au Cambodge. » Les gouvernements n’étaient plus appelés à « empêcher le retour à des fonctions gouvernementales des personnes responsables d’actes génocidaires pendant la période 1975-1978 ».
De telles garanties d’impunité pour les génocidaires faisaient également partie du « plan de paix » de l’ONU rédigé par les membres permanents du Conseil de sécurité, c’est-à-dire par les États-Unis. Afin de ne pas offenser les principaux soutiens de Pol Pot, i.e. les Chinois, le plan a laissé tomber toute mention de « génocide », le remplaçant par l’euphémisme « politiques et pratiques du passé récent. » Henry Kissinger, qui a joué un rôle de premier plan dans les bombardements massifs du Cambodge au début des années 1970, a eu une influence importante à cet égard.
Avant le « processus de paix » de l’ONU au Cambodge, la propagande occidentale se concentrait sur la puissance des Khmers rouges, afin de justifier leur inclusion. Les responsables de l’ONU et les diplomates américains et australiens parlaient de 35 à 40 000 Khmers rouges. « Vous comprenez, disaient-ils, que nous ne pouvons pas laisser une force aussi puissante en dehors du processus ». Dès que les Khmers rouges sont rentrés de nouveau à Phnom Penh et se sont vu dans les faits, attribuer entre un quart et un tiers du territoire du pays, ils ont refusé de participer aux élections. Le ton a alors changé. Ils étaient désormais « finis », ont déclaré en chœur les diplomates occidentaux. Ils étaient « affaiblis au-delà même de toute espérance. »
Dans le même temps, les Khmers rouges s’imposaient comme le groupe terroriste le plus riche de l’histoire en vendant des parcelles de forêts cambodgiennes, ainsi que les pierres précieuses du pays, aux Thaïlandais, dont le gouvernement était signataire des « accords de paix. » Plus rien ne les arrêtait. Ils ont établi quatre nouvelles bases importantes en Thaïlande, toutes dotées d’un hôpital de campagne. Des soldats thaïlandais gardaient la route qui y menait. L’expression « Ils sont finis » reste en vogue encore aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que leurs effectifs ont diminué en raison des défections et de l’attrition, mais leur nombre n’a jamais été un indicateur fiable de leur véritable puissance. Il semble que le Département d’État estime qu’ils sont loin d’être finis.
Le 10 juillet dernier, le porte-parole Nicholas Burns a laissé échapper que les Khmers rouges comptaient « des milliers » de membres.
La véritable menace que représentent les Khmers rouges réside dans leur habileté à tromper et à infiltrer. Avant de prendre le pouvoir en 1975, ils avaient déjà infiltré Phnom Penh. Ce processus est très certainement en train de se reproduire. Comme l’a récemment déclaré un habitant de Phnom Penh, « Ils sont partout ». Le « procès » de Pol Pot cette année était une magnifique mise en scène médiatique des Khmers rouges, mais il n’avait aucune valeur en tant qu’indicateur de la force et des objectifs immédiats de l’organisation. La vérité est que personne à l’extérieur ne peut vraiment dire ce que sont ces objectifs, et cela seul est un indicateur de la force et de la résilience de l’organisation. Le dirigeant cambodgien Hun Sen, pour sa part, observe clairement un certain respect quant à la réalité et à la menace que représentent leurs ambitions.
Les médias se délectent de Pol Pot comme d’un monstre unique. C’est trop facile et trop dangereux. Ce sont ses partenaires faustiens à Washington, Pékin, Londres, Bangkok, Singapour et ailleurs qui méritent d’être reconnus à leur juste valeur. Les Khmers rouges leur ont été utiles pour atteindre tous leurs objectifs communs dans la région. Eric Falt, porte-parole en chef de l’ONU à Phnom Penh au moment du « triomphe » de cette organisation instrumentalisée au Cambodge, m’a dit avec un rictus : « Le processus de paix visait à permettre [aux Khmers rouges d’acquérir une respectabilité. » Malheureusement, de nombreux Cambodgiens ordinaires partagent son cynisme. Ils méritent mieux.
Lien vers l’archive de l’article original
Source : The World Traveler, John Pilger, 10-07-1997
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s'arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs - et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation.






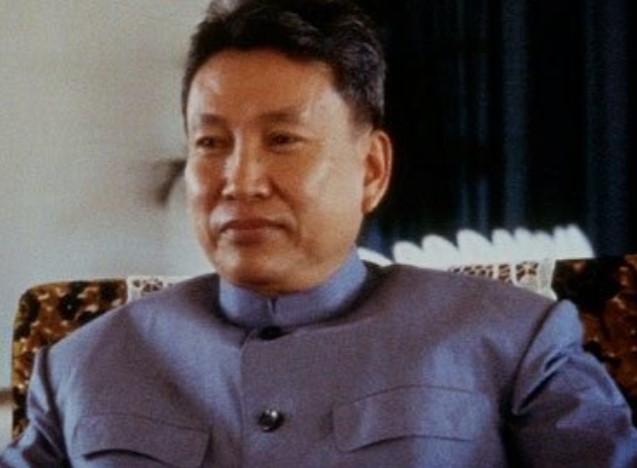










Commentaire recommandé
Encore un génocide soutenu par l’empire anglo-saxon, dont plus grand monde ne croit à leur volonté d’apporter la « démocratie » dans les pays qu’ils détruisent.
3 réactions et commentaires
Encore un génocide soutenu par l’empire anglo-saxon, dont plus grand monde ne croit à leur volonté d’apporter la « démocratie » dans les pays qu’ils détruisent.
+14
AlerterC’est sympa de nous ressortir ça alors que le Cambodge et la Thaïlande sont à couteaux tirés … (pour des histoires de cailloux qui brillent à la con … le coup des temples c’est du pipo : si j’avais le fion doré, la CIA en ferait un temple ^^. )
+4
AlerterIl serait bon de se rappeler aussi que le soutien de Pol-Pot à l’ONU fut aussi le fait de notre chère France.
+6
AlerterLes commentaires sont fermés.